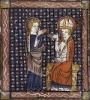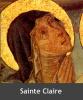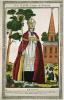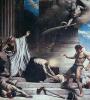Saints
Saint Bertrand
Il existe plusieurs évêques français connus comme Bertrand de L'Isle ou de L'Isle-Jourdain :
Bertrand de L'Isle-Jourdain ou de Comminges (vers 1050, L'Isle-Jourdain - 1123, Lugdunum Convenarum), évêque de Comminges (1073 - 1123), canonisé par le pape Honorius III entre 1220 et 1222.
La légende dit que par la puissance de sa foi Saint Bertrand fit mourir un crocodile qui terrorisait la population. On peut voir le crocodile dans la cathédrale de Saint Bertrand de Comminge.
Bertrand de L'Isle-Jourdain ou de Toulouse (vers 1230, L'Isle-Jourdain - 1286, Toulouse), évêque de Toulouse (1270 - 1286).
Saint Blaise
Médecin et évèque à Sébaste au IIIème siècle en Arménie, martyrisé le 3 février 316. Saint dit "auxiliaire" car ils ont le pouvoir d'intercéder directement auprès de Dieu. Messe le 3 février à Horsarrieu jour de la fête de ce saint. Fontaines à Commensacq, Horsarrieu, Rivière Saas et Gourby, Le Sen, Sort en Chalosse,
Saint Blaise est un des saints protecteurs les plus vénérés en Europe. Beaucoup d'églises lui sont consacrées. De nombreux corps de métiers en fait leur saint patron : les bergers, les cardeurs de laine, les tailleurs de pierre, les vignerons, etc.
Les reliques reposant à Metz, attirent depuis six siècles les pèlerins avec la réputation de guérir les maux de gorge. Sa fête est le 3 février
Saint Brice
Evêque de Tours décédé vers 444
On dit qu'il fut recueilli et protégé par saint Martin, mais que Brice quitta le monastère "pour vivre avec de beaux chevaux dans ses écuries et de jolies esclaves dans sa maison."
A la mort de saint Martin, il changea sa manière d'agir. Il lui succéda sur le siège épiscopal de Tours, donnant toute sa vie à l'Église durant quarante ans.
Calomnié, accusé d'avoir rendu mère une de ses religieuses, il dut même aller se défendre devant le pape.
Mais ses ouailles reconnurent l'innocence de sa vertu et le firent revenir pour qu'il soit à nouveau leur évêque. Ils le canonisèrent dès sa mort.
Image représentant St Martin et St Brice
Saint Cérase ou Cérat
évêque d'Eauze (Ve siècle)
Gérase, Cérase ou Cérat.
6e évêque de Grenoble (439-450), Cérat se montre soucieux de la discipline chrétienne du clergé et des fidèles. Il lutte contre l'arianisme, affirme la primauté du pape et confesse sa foi par l'exil. Il meurt vers le milieu du Ve siècle. (saints du diocèse de Grenoble)
Un burgonde qui fut évêque de Grenoble et dont le pape saint Pie X a confirmé le culte millénaire en 1903.
Evêque évangélisateur du sud du département du Gers: saint Cérase (24 avril), mort à Saintes près de Simorre. (Quelques saints gersois - calendrier officiel du diocèse d'Auch - L'Eglise du Gers et son histoire - texte en pdf)
Saint Cérase (ou Cérats), évêque, évangélisateur de l'Astarac, mort à Saintes, près de Simorre.
Paroisse Saint Cérase de Saramon-les-4-Vallées, secteur pastoral de Save-Gimone.
Tu gémissais, ô terre simorraine
Dans les chemins ténébreux de l'erreur,
Mais un apôtre a délié la chaîne
Que t'imposait Satan ton oppresseur...
(Cantique à Saint Cérase)
St Cérats ou Cérase est né dans le Pays des Allobroges (Dauphinée-Savoie) vers la fin du IVe siècle au sein d'une famille patricienne. Il fait ses études à Milan auprès de St Ambroise (archevêque de Milan, 340-397). Il succède par la suite à St Domnin comme 7e évêque de Grenoble. En 441 et 442 il participe respectivement aux conciles provinciaux d'Orange et de Vaison. En 451 les Burgondes devenus ariens et donc séparés de l'église romaine catholique le forcent à quitter Grenoble. Il arrive en Astarac avec deux de ses diacres (Gervais et Protais), et consolide la foi dans la vallée de la Gimone. Il fonde un oratoire à Simorre et devient selon certains écrits évêque d'Eauze. Vers la fin de sa vie, il se retire avec ses deux diacres dans une forêt au nord de Simorre et c'est alors que commence une série de prodiges (guérisons miraculeuses, résurrection d'un mort...). Ce lieu fut appelé Saintes (Sancta Loca). Le 8 des ides de juin (6 juin) de l'an 420 (année donnée par Dom Brugelles) St Cérats s'éteint.
Le peuple et le clergé de Simorre mirent son corps dans un tombeau en marbre recouvert d'un voile et le déposèrent dans l'église Saint André hors les murs de la ville de Simorre. La foule venait nombreuse pour vénérer les reliques de St Cérats. Aux environs du XIe ou XIIe siècle, un 24 avril de cette époque, les reliques du saint furent translatées de l'église St André dans l'église abbatiale de Simorre. Le 24 avril devint le jour de la fête patronale et locale de Simorre...
Réf : textes tirés du livre de l'abbé Clermont, St Cérats sa vie son culte - 1926
(Mairie de Simorre - découvrir Simorre)
Au martyrologe romain au 6 juin: À Grenoble, vers 452, saint Cérase, évêque, qui remercia saint Léon le Grand pour son Tome à Flavien et préserva son troupeau de l'hérésie.
Martyrologe romain
Saint Christau
Saint-Christau est une ancienne commanderie dépendant de l'abbaye de Sainte-Christine du Somport, accueillant les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle. Pierre de Marca nous apprend que le dernier jour d'avril 1289, Gaston VII Moncade (+ 1290) obtint une promesse solennelle de ses filles (Marguerite, Constance, Guillelmine et Marthe) de respecter ses volontés, par un serment qu'elles firent "au lieu d'Eysus, près d'Oloron où était assise la Commanderie de Saint Christau, dépendante de Sainte Christine". Son nom était la Commanderie du Bager d'Eysus, vulgairement appelée Saint Christau. L'hôpital fonctionna jusqu'en 1553, date à laquelle les biens du monastère furent sécularisés et vendus. Un long procès montra que si les bâtiments relevaient autrefois d'Eysus, les sources, elles, appartenaient à Lurbe, d'ou le nom actuel de Lurbe-Sain Christau. Lurbe et Saint-Christau se sont unies en 1955.
Saint Christophe
Qui est Saint Christophe (IIIe s.) ?
La légende de saint Christophe revêt divers visages, mais on peut la résumer ainsi. Homme d’une force extraordinaire, Offero désire se mettre au service du plus grand roi du monde. Pour ce faire, il parcourt son pays et, après avoir servi les rois de sa région, finit par se mettre au service de Satan.
Un jour, il rencontre un ermite qui le convertit et l’engage à servir le Christ en accomplissant la tâche qui lui conviendrait le mieux. Offero se fait alors passeur, transportant sur ses épaules les voyageurs qui désirent traverser la rivière. Une nuit d’orage, un enfant se présente et demande le passage. Offero finit par accepter, mais au fur et à mesure qu’il avance dans l’eau, l’enfant se fait de plus en plus lourd. Arrivé sur l’autre rive, le passager révèle au géant qu’il a porté sur ses épaules tous les péchés du monde et lui demande de planter dans le sol son bâton. Aussitôt, celui-ci se met à fleurir.
Et Offero, qui sera désormais appelé « Christophe » (ce qui veut-dire « porte-Christ »), reconnaît alors l’Enfant-Jésus, le roi du monde qu’il va dorénavant servir.
Saint Clair ou Sainte Claire
Clar en gascon, qui par son nom est adapté aux yeux né vers la fin du I er siècle, saint normand,. peut-être en Afrique évangélisera l’Aquitaine et fût martyrisé à Lectoure (Gers) mort en martyr en 884,dévotion le 1er juin à Bougue pour soigner les maux des yeux. Une fontaine dédiée à : Boos, à Bougue (propriété privée non accessible), Commensacq, Saint Paul en Born, Souprosse, Vert et Ygos St Saturnin.
Saint Clair faisait autrefois l'objet d'une vénération particulière dans tout le sud-ouest et principalement à Bordeaux depuis que l'armée de Charlemagne y déposa ses reliques que l'on peut voir dans la chapelle St Clair de l'église Sainte Eulalie à Bordeaux.
Il avait été sacré Evêque par le pape Anaclet qui l'envoya en l'an 104 avec quelques compagnons évangélistes la "novempopulanie" à peu près l'actuel département du Gers. C'est dans cette région à Lectoure exactement qu'il fût décapité et mourut en martyr.
Claire d’Assise, patronne des aveugles et des handicapés de la vue.
Saint Claude
Évêque de Besançon.
D'abord militaire, il embrassa la vie monastique à Condat dans le Jura avant d'être élu évêque de Besançon. Mais dès qu'il le put, il résilia cette charge pour rejoindre la solitude.
Son monastère et le village voisin prirent son nom et le diocèse s'est placé sous son patronage: Saint-Claude-39200.
...Claude, abbé de Saint-Oyend-de-Joux, administre cette abbaye durant près de 50 ans, du milieu du VIIe siècle (vers 650) jusqu'à la fin du VIIe siècle (vers 695). Il est revêtu 7 ans de la dignité épiscopale, sans doute d'évêque claustral. De son administration, nous savons qu'il cherche à subvenir aux besoins croissants de son abbaye et qu'il contribue à son développement et à son rayonnement. L'histoire apporte peu de certitude sur la vie et la personne de saint Claude. La tradition veut qu'il soit né à Salins d'une famille gallo-romaine et qu'il ait été évêque de Besançon. Cet homme, qui de son vivant mène une vie humble et rigoureuse, va connaître après sa mort une "renaissance" prestigieuse. En effet, 500 ans après sa mort, grâce à la conservation intacte de son corps, de nombreux pèlerins accourent vers l'abbaye où les miracles se multiplient...
(Qui est saint Claude? - Eglise du Jura)
Dans le Jura, vers 703, saint Claude, qui fut, croit-on, évêque et abbé du monastère de Condat.
Source Nominis
Saint Denis
L'austère Denis des temps anciens fait place à de petits Denis d'allure plus sympathique, plus humaine, plus immédiatement accessible aux yeux des fidèles et des pèlerins. Dans ce contexte apparaissent aussi des représentations de saint Denis 'à deux têtes',où le saint évêque, la tête bien plantée sur les épaules, tient en outre dans ses mains sa tête coupée qu'il semble offrir à la dévotion des fidèles. Le saint apparaît donc ici comme un être bien vivant auquel le dévot peut s'adresser directement tandis que la tête coupée se voit réduite au rang de simple attribut permettant l'identification du personnage.
Fontaine à Larrivière, Moliets et Mâa
Si le lieu, par excellence, où l'on vénère le saint patron du royaume reste la basilique de Saint-Denis, de très nombreux sanctuaires moins connus - églises paroissiales ou simples chapelles - ont développé un culte à saint Denis dans diverses régions de France. Dans certains cas, il se peut que notre saint ait pris la place d'un ancien culte païen rendu au dieu grec Dionysos mais, le plus souvent, il s'agit de domaines ruraux ayant appartenu à l'abbaye de Saint-Denis ou de fondations pieuses édifiées plus tardivement en l'honneur du saint.